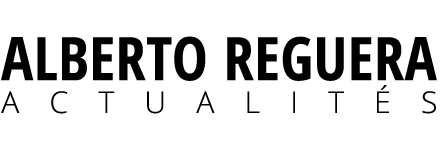Conversation entre Guillermo Solana et Alberto Reguera
Guillermo Solana : Les peintures que vous présentez dans cette exposition ont été créées en hommage à une œuvre du musée Thyssen, Chemin longeant un canal au clair de lune, du peintre Aert Van der Neer. Ce tableau constitue le point de départ de votre travail y compris par son format, n’est-ce pas ?
Alberto Reguera : Effectivement. Le tableau de Van der Neer et son cadre mesurent 35,6 cm x 65,5 cm x 7,5 cm et j’ai commandé les structures en bois en respectant cette proportion. Dans certains cas, j’ai dû élargir le rebord pour m’assurer qu’il puisse soutenir la structure. L’une de mes obsessions est de penser le tableau comme objet, l’objectification de la peinture.
GS : Il est curieux que vous vous soyez intéressé à une petite toile dont peu de visiteurs se souviendront…
AR : Oui, mais ce qui m’intéresse avant tout dans ce paysage est que le grand soit contenu dans le petit. J’étais également attiré, bien sûr, par ce nuage qui filtre la lumière de la lune. Ces nuages changeants et leurs gammes de couleurs font écho à l’une de mes propres obsessions, les textures célestes sur lesquelles je m’emploie à travailler.
GS : Van der Neer s’est spécialisé dans les paysages nocturnes, au clair de lune. Vous avez vous-même peint de nombreuses toiles nocturnes ainsi que des paysages à la lumière tamisée de l’aube ou du crépuscule.
AR : L’atmosphère nocturne constitue pour de nombreux peintres une ouverture sur l’imaginaire, à la frontière entre le visible et l’invisible. Parce que tout y est plus indéfini, plus flou, le peintre a la possibilité d’utiliser sa palette pour créer différentes nuances, plusieurs dégradés et ouvrir la voie au subtile. Pour peindre la nuit, il faut savoir devenir soi-même plus subtil et plus imaginatif.
En peinture, la nuit n’est pas noire ; elle s’exprime surtout par le bleu, et personnellement j’aime le bleu de Prusse. Lorsque, par une nuit d’été, vous regardez les étoiles, la profondeur ressemble à un tissu de velours et il est impossible de définir où elle commence et jusqu’où elle va. Déjà, Kandinsky disait que le bleu était la couleur la plus spirituelle. Plus le bleu a de profondeur, plus il est spirituel. C’est une couleur plus intangible, qui a peut-être plus d’apesanteur que les autres.
Nuages
GS : Vous avez évoqué un autre élément caractéristique de votre peinture, le nuage, les nuages.
AR : Absolument. Le nuage est au cœur même de la peinture paysagère, et pas seulement chez les Hollandais. On le retrouve dans la peinture chinoise, par exemple. Les Chinois se fondaient sur un concept où le nuage servait d’intermédiaire entre la montagne et le ciel, d’abord par le vide, puis par le trait. Et ce vide finissait par être occupé par la condensation des gouttes d’eau sous la forme de montagnes. C’est la notion du shanshui (montagne-eau). Pour les peintres chinois, le nuage est une sorte de démiurge garant des équilibres, des harmonies, à créer entre le haut et le bas. Wang Wei, poète et peintre de la dynastie Tang, parlait du nuage comme d’un élément, qui en bout de course, finit par céder le pas à un rayon de clarté, à un halo de lumière où le nuage et l’orage ont disparu.
De plus, le nuage est par nature éphémère et en mouvement constant ; chaque instant est unique parce que le nuage est en perpétuelle formation et transformation. C’est pourquoi le nuage est une allégorie du temps. En Occident, après les Hollandais, le nuage devient le protagoniste du paysage du XIXe siècle, des romantiques jusqu’aux impressionnistes. Songeons à ces compositions ascendantes, qui donnent l’impression que le nuage cherche à s’échapper du cadre, à la représentation que ces peintres font des nuages, en séquence et selon des formats horizontaux et qui, ne sont rien d’autre qu’un récit, mais le récit de la nature, bien sûr.
Voyages
GS : Vous avez une résonance particulière à la peinture paysagère hollandaise, tout comme au paysage naturaliste hollandais.
AR : Lorsque je suis allé aux Pays-Bas pour la première fois, j’ai renoué avec quelque chose de l’univers esthétique du paysage castillan : le haut et le bas, l’horizon, ce monde rothkien et cela m’a beaucoup influencé. Disons que cela a généré toute une série d’esquisses qui n’ont pas été matérialisées, mais que j’ai gardées en mémoire. Je créais des ébauches mentales de mon ressenti du paysage à un moment donné et qui m’ont par la suite inspirées une série de peintures.
GS : Il est un autre voyage que vous évoquez souvent, celui que vous avez fait en Norvège.
AR : Je suis allé en Norvège en 1998 mais avant cela, j’imaginais déjà et je peignais déjà des paysages norvégiens. J’avais découvert dans une exposition un photographe suédois du XIXe siècle, Axel Lindahl, qui photographiait le paysage norvégien. Ses photographies représentaient déjà des univers, le reflet des montagnes… un peu comme Monet lors de son voyage en Norvège. Mais curieusement, j’ai été plus frappé par la Norvège de Lindahl que par celle de Monet. Donc, deux ans avant de me rendre en Norvège, je peignais déjà les fjords en m’inspirant de ces photos. Puis, j’ai commencé à utiliser le pigment ; j’ai commencé par un jeté à la verticale, plutôt qu’à l’horizontale, pour créer une sorte de…
GS : Rideau ?
AR : Oui, des rideaux lumineux. Et le fjord est comme une cathédrale de la nature. En 1998, Violette Heger-Hedløyme, alors galeriste, m’a convaincu d’aller en Norvège, ce qui a été pour moi une grande expérience. J’ai pris le Hurtigruten, un bateau qui va jusqu’aux îles Lofoten et qui s’arrête dans les fjords. Être à bord de ce bateau, entre le ciel, la mer et la terre est quelque chose d’extraordinaire. Et le plus curieux, c’est que j’ai retrouvé des paysages que j’avais peints. Je me souviens de rêver la nuit de mes tableaux en mouvement, intégrés dans le paysage. Au fur et à mesure que nous remontions sur le bateau, l’horizon se perdait dans la fusion du ciel et de la terre. C’est, je pense, ce qui m’a influencé et m’a fait perdre les complexes de vouloir être un peintre purement abstrait et m’a ouvert aux paysages. Ce voyage a été un véritable apprentissage.
Puis il y a eu d’autres voyages. En 2006, je suis allé en Nouvelle-Zélande parce que je voulais me rendre à l’extrême opposé, dans une nature également très proche du pôle mais, beaucoup plus foisonnante. Lorsque tu découvres un paysage si proche de ton univers, tu te demandes ce que tu peux bien apporter de plus avec la peinture. C’est alors que j’ai fait plus de photographie que de peinture. Naturellement, avec la photographie je peins aussi, mais avec l’œil.
Musique
AR : Il y a ainsi un thème qui est lié au voyage, celui de la fugue. J’ai toujours peint des tableaux qui fuient.
GS : Un de ces tableaux s’intitule Paysage en fuite…
AR : C’est parce que tout est mouvance, tout renvoie aussi au nuage qui semble vouloir sortir du cadre. Et moi-même, je suis aussi dans cette sorte de fuite.
GS : Je vous ai entendu faire une analogie avec la fuite musicale. Il y a une première voix, puis une deuxième, voire une troisième et une quatrième voix.
AR : C’est cela. Ce sont des couches qui se superposent pour créer au final une polyphonie. Disons que s’il est vrai que le voyage est une source d’inspiration, la musique en est une autre, tout aussi importante. Je peins presque toujours en musique, parce que, dans mon atelier, elle me plonge dans une atmosphère, une ambiance où j’entre en résonnance. Je crois au pouvoir de la synesthésie, peindre le relief de la musique, si l’on évoque mes textures, transformer les sons en couleurs. A l’instar des expériences de Kandinsky, Scriabin, Mark Tobey et John Cage. J’ai peint une toile intitulée Vibraciones de Mozart qui a été exposée à l’UMAG Museum de Hong Kong, en 2015, et j’ai peint des tableaux Telemann, des tableaux Mendelsohn, des tableaux Grieg, des tableaux Sibelius, des tableaux Satie… J’ai également collaboré avec un musicien néerlandais contemporain, Bart Spaan, qui s’est inspiré de ma peinture pour composer et moi de sa musique pour peindre.
GS : Vous dites souvent que Haydn est votre musicien préféré.
AR : C’est le maître par excellence. Ses symphonies transmettent comme une vibration vitale, des Sturm und Drang protoromantiques mais fortement imprégnées de romantisme jusqu’aux symphonies de Londres. J’aime à peindre l’éclat solaire sur la musique de Haydn. Moi qui vis entre Paris et Madrid, cela m’évoque un dimanche parisien, un matin de ciel dégagé, un matin radieux où je peins sur la musique de Haydn…
Haydn m’aide à créer ces sortes de mélodies picturales et il m’accompagne aussi dans mes actions picturales, face au spectateur, comme celles que j’ai faites récemment en Chine.
Matières
GS : Vous travaillez toujours avec la matière picturale en expérimentant sur cette matière.
AR : je crois que cette obsession pour la matière tient aux réminiscences de mon enfance. Je suis né en Castille, une région riche de ses textures d’océans de blé. Et je me souviens, enfant, d’observer les murs et leurs craquelures (pour un enfant, un mur est un univers à lui tout seul) et ce sgraffite si caractéristique de la ville de Ségovie. De là, viendrait cette obsession pour la création de la matière picturale, de la création d’une superposition de couches et du raclage. Plus tard, à l’âge de 20 ans, j’ai commencé à visiter les musées et j’ai découvert les grattages de Max Ernst. Cette idée de gratter de la matière pour ensuite en remettre, de déconstruire pour ensuite construire. Et au final, après ces couches et ces raclages, que reste-t-il ? Ces couches, ces strates de chair à vif, tout cela doit être refermé, il faut y mettre comme un voile. Comment le rendre plus subtile ? C’est là que j’ai commencé ma recherche avec les pigments.
GS : Le pigment en poudre comme un voile…
AR : Le pigment est une matière qui capte la lumière et la déshabille, il a cette double capacité. Mais pour créer ce voile, il faut l’appliquer sur une superficie douce. Sur une toile inclinée je commence par le jeter, comme si je semais la toile. Peut-être de façon inconsciente, ce geste est-il un acte, un geste d’action picturale : saupoudrer le pigment sur la matière douce pour créer cet ensemble de textures, ce glacis à travers lequel va filtrer la lumière. Je veux que les couches sous-jacentes soient visibles, mais toutes unies par un manteau de pigment qui pourrait être, par exemple, un bleu de Prusse ou un jaune incandescent.
Par ailleurs, en lançant le pigment selon une trajectoire donnée, j’essaie d’imiter l’effet de la lumière qui illumine le paysage. Si je le lance depuis l’une des extrémités de la toile, le relief du paysage semble éclairé par la lumière rasante de l’aube ou du crépuscule. Je pourrais également recréer l’intensité lumineuse de ma Castille natale à la mi-journée en lançant le pigment face à la toile, et si je le fais depuis d’autres angles, cela donnera lieu à d’autres textures.
Cosmique
AR : Somme toute, c’est le pigment qui peu à peu créer le tableau, le tisse peu à peu. Et surgit alors le côté un peu cosmique, mystérieux… ce qu’une grande poétesse, Andrée Chedid, appelait l’étoffe de l’univers, la matière, le tissu de l’univers.
Je pense que ma vision du paysage ne s’arrête pas à la surface de la Terre. J’ai une notion plutôt transversale de la peinture. Je peux peindre des océans de blé, puis le ciel, les nuages, en commençant pas les plus bas, puis les plus élevés. On s’élève peu à peu, on plonge dans l’atmosphère jusqu’à la stratosphère et on arrive au cosmos. Beaucoup de mes tableaux sont très cosmiques. C’est cette structure d’éléments microscopiques qui constitue le pigment, et les pigments qui s’assemblent en une sorte de mosaïque, le tout formant la tapisserie de l’univers. En d’autres termes, ma peinture a un côté très terrestre, mais aussi un côté très cosmique, et parfois elle va d’un extrême à l’autre.
GS : Ce matin, je lisais dans un journal un reportage sur ce nuage gazeux de 3 500 années-lumière de long qui parcourt la Voie lactée. Je me suis souvenu de votre peinture parce qu’elle est empreinte d’une iridescence à la luminosité changeante.
AR : Nous sommes désormais habitués à reconnaître les topographies étrangères à notre planète, celles de la Lune ou de Mars, qui jadis étaient insolites et aujourd’hui peuvent être vues sur Instagram. Nous sommes désormais habitués à voir des images, telles que les tempêtes sur Jupiter qui dépassent les dimensions de la Terre.
Il est extraordinaire de penser que l’univers créé une géométrie que l’homme serait bien incapable de produire. Les anneaux de Saturne, par exemple, sont en réalité des éléments de poudre qui s’alignent et forment une sorte d’armée chromatique. Ils s’alignent à la perfection autour de quelque chose au pouvoir d’attraction plus ou moins grand. La peinture géométrique dans son absolu.
GS : La première de vos toiles évoque ces processus.
AR : Oui, des processus, disons, cosmiques. Je pense également à la matière noire, une extrapolation, le monde nocturne se faisant cosmos. Tu vois un regroupement mais en réalité, tu ne sais plus si c’est un nuage ou une énorme nébuleuse. Et tout au milieu se trouve la matière noire.
Le point de vue
AR : Je travaille avec des pigments métalliques depuis très longtemps, des pigments de cuivre, d’argent, d’iridium… ce sont des pigments iridescents qui changent selon le point de vue du spectateur. Selon l’incidence de la lumière, ce même pigment apparaît sombre ou brillant et permet de voir différents tableaux.
Cet effet changeant selon la perspective, m’a amené à impliquer le spectateur. À lui faire comprendre que selon l’endroit où il se trouve, il peut construire sa propre version de l’œuvre d’art. S’ouvrir à cette variation.
GS : Cette interaction avec le spectateur exige un tableau en trois dimensions, n’est-ce pas ?
AR : Dans ma peinture, il y a toujours eu, et de façon naturelle, un processus d’application de couches. Lucio Muñoz me disait : « Ta démarche dans la peinture est celle d’un pendule. Dans certains cas, il y a de très nombreuses couches et dans d’autres c’est très plat, tout plat ». Les tableaux qui cumulent les couches se transforment au final en un paysage imaginaire et abstrait mais également en un objet. C’est ce que Canogar me disait également :” tu objectualises le paysage ».
La peinture comme objet
GS : Cette dimension d’objet de ta peinture s’est développée au fil du temps, n’est-ce pas ?
AR : La peinture est à la fois une fenêtre par laquelle pénètre notre regard et un objet qui vient à notre rencontre, qui s’extrait du mur et nous interpelle ; un objet qui demande aux spectateurs de se déplacer autour de lui dans le but de donner naissance à différents tableaux.
J’avais peu à peu épaissis l’armature d’une toile, tant et si bien qu’un jour, tout simplement et de la façon la plus spontanée je l’ai posée par terre parce qu’elle était si épaisse qu’elle pouvait être posée au sol et que j’avais peu de place dans mon atelier. A ce moment là, le téléphone a sonné et je l’ai laissée là et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que le tableau pouvait prendre ses distances par rapport au mur. Alors, j’ai ajouté un autre tableau pour voir le résultat, puis j’ai posé au sol d’autres tableaux de différentes tailles. Je me souviens qu’en voyant cela, un de mes amis français m’a dit : « c’est comme une famille de tableaux, comme une représentation abstraite de Las Meninas ».
Pour Joselina Cruz, commissaire de la Biennale de Singapour en 2008, c’était comme briser les divergences historiques entre peintures et installations, a-t-elle écrit. Il est curieux, en outre, que ce processus ait surgit alors que je commençais à me faire connaître en Asie, en 2007. Alors, est née l’envie de créer des atmosphères à volume, des coups de pinceau à volume et de produire un tableau ayant un volume. Et d’inviter le spectateur à se promener parmi ces volumes et à se créer sa propre perspective, son propre champ de vision, à construire lui-même son tableau.
Donc, il semble de fait que tout cela réponde, depuis le début, à une démarche logique, celle de créer des textures jusqu’à ce que la matière déborde et se transforme en objet indépendant.
Actions picturales
GS : Et le passage de l’objet à l’action picturale, dites-moi quand et comment vous avez fait ce pas.
AR : Vers 2007, j’ai commencé à vouloir projeter ma peinture dans l’espace, d’abord à l’horizontale, par une série d’installations picturales, en plaçant les tableaux au sol. Mais dans le même temps, dans ma démarche de recherche sur mon travail et l’espace, j’ai commencé à faire de l’expansion de peinture à partir de mes toiles tridimensionnelles que je plaçais sur divers supports, comme une toile vierge ou un mur. Je faisais de l’expansion de peinture sur ces superficies, un peu comme si l’œuvre d’où surgit la couleur recrachait la matière.
GS : Le tableau sculpte sa couleur ; il diffuse sa peinture autour de lui…
AR : Absolument. Parce que je me disais : ici, j’ai un univers, on parle d’un nuage non ? C’est comme si l’on avait mis un nuage dans un carton, dans une boîte transparente, sur laquelle j’ouvrais une entaille pour apercevoir les entrailles du tableau. Alors, je veux que le nuage se libère de ce trop plein de matière, qu’il l’expulse et crée divers chemins, des parcours de matière, soit sur un mur pour gommer les limites de l’infini, soit sur une toile dont nous connaissons les limites. Le débat n’en reste pas moins celui du support. Alors, dans une sorte de fuite, dans ce combat pour ne pas me laisser enfermer, à partir de 2010, j’ai fais le pas suivant : pourquoi ne pas poser un tableau tridimensionnel au mur et en faire une expansion devant le public ? Inviter ainsi le public à assister à cette action où le geste est plus important que le résultat. Et c’est alors ce que j’ai créé, devant un public, une expansion de la toile comme si sa substance, sa vie même lui échappait.
Je me souviens de cette expérience au Hay Festival de Ségovie, en 2019, devant 400 ou 500 personnes, où je n’avais rien prévu ni planifié car il me semblait plus intense et stimulant de laisser fuser la matière au bon moment, au son de la musique. En outre, il risquait de pleuvoir ce jour là. Au commencement, je voyais que le visage des gens était très inquiet…, même si parfois j’essayais d’éviter leurs regards parce que le public était imposant. Les gens, au début, semblaient inquiets parce que j’ai commencé tout doucement. Je dois commencer tout doucement pour trouver ma place dans l’espace. Ensuite, une fois que tu es entré, tu te laisses porter et tu deviens toi-même le pinceau.
Dans le musée où nous sommes, par exemple, il y a une toile de Morris Louis dont l’artiste n’a pas touché la superficie. Il a seulement versé la peinture en maîtrisant le flux par l’inclinaison de la toile dans un sens ou dans l’autre pour créer des coulées. Et bien, dans mes actions, il y a quelque chose de semblable, avec ceci qu’elles se font devant un public et s’accompagnent d’un risque et d’une limite de temps. Le corps prend ici une importance majeure, le corps en mouvement. Et c’est là que se fait l’intersection avec d’autres formes d’art telle que la danse, parce que tu te rapproches et tu t’éloignes à nouveau, dans une sorte de danse qui passe par la toile.
GS : Cela me rappelle les actions picturales de Robert Rauschenberg ou de Yves Klein.
AR : Dans ce type d’expansion, aussi bien en public qu’en privé, mon engagement est non seulement dans l’interaction avec le spectateur, mais également dans la représentation du côté intangible de la peinture, de ce qui l’enveloppe comme une aura. En d’autres termes, la peinture occupe un espace plus important que celui que nous lui accordons sur le plan physique. Les vibrations, ou l’aura, est ce que je cherche à matérialiser à partir de ces coulées ascendantes ou de ce jeté.
Je cherche à voir comment la peinture peut élargir nos horizons et souligner la pertinence de la peinture dans un moment comme celui-ci. Ce que je veux dire, c’est que l’on peut faire beaucoup de choses à partir d’un tableau classique ou d’un tableau plat. Il est possible de le mettre en expansion et de le faire revenir ensuite à son point de départ. Par exemple, un de mes tableaux est en ce moment exposé à Pékin. Or ce tableau s’est à nouveau détaché de son expansion. Et ce même tableau, dans deux ans…
GS : Pourra engendrer d’autres expansions.
AR : Le même tableau aura plusieurs vies. Et pas simplement grâce à de nouvelles expansions ou à leur intégration dans des installations picturales où l’œuvre fonctionne à la fois comme peinture et comme sculpture. Il aura plusieurs vies grâce à d’autres disciplines, au-delà du concept d’art contemporain. Ainsi la musique, en tant qu’instrument de synesthésie, comme nous l’avons vu, ou encore la danse ou la poésie car nous avons fait des exercices de récital. On peut peindre en étant inspiré par quelqu’un qui récite un poème et c’est également très intéressant et par ailleurs beaucoup plus risqué.
Je me souviens qu’après mon action performative au Hay Festival, Ángela Segovia et Antonio Lucas prenaient la suite pour réciter leurs poèmes, tandis que ma toile restait là pour sécher. L’attention du public s’était alors portée sur les poèmes et Antonio Lucas dit à voix haute : « Et voici là le peintre qui tout doucement regroupe ses pots et referme ses pots ». En d’autres termes, après ce moment si intense, le temps est venu de rassembler les pots de peinture pour que la peinture ne sèche pas et de revenir à la réalité.
De même, lors d’une action de peinture en expansion devant un public, il ne faut pas craindre que la pluie, les éclairs ou le tonnerre soient de la partie. Parce que si nous sommes si admiratifs face aux éléments atmosphériques d’un tableau, au cœur même du tableau, etc. qu’y a-t-il à craindre ?… Après avoir taché un mur de peinture et créé une scène unique, est-ce une averse qui va t’effrayer ? Peut-être même la pluie t’aidera à créer ces coulées. Les grands peintres paysagistes, quand ils sortaient de leurs ateliers, étaient bien conscients qu’ils prenaient des risques. Et il faut être prêt à affronter ces risques.
Traduction : laurence.correard@gmail.com